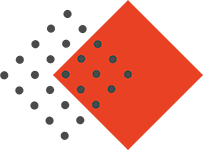
Face aux enjeux de la transition, chaque citoyen est confronté à la question du sens, c’est-à-dire de la signification et de l’orientation, de ses choix. Quel type d’alimentation ou de transport privilégier ? Quelle orientation professionnelle ? Quels loisirs ? Comment vivre et agir de façon juste dans un monde incertain, sans se laisser terrasser par une responsabilité perçue comme écrasante, par un sentiment d’impuissance et par le constat de l’insuffisance des mesures prises ? Ces questions se posent encore différemment pour celles et ceux déjà marqués par la grande précarité ou la misère et qui risquent d’être doublement touchés par les conséquences sociales des crises ― la crise du COVID-19, en 2020, le montre bien. La description des tendances globales que ne parviennent pas à infléchir les réponses proposées à la crise socio-environnementale menace de perte de sens les actions individuelles et collectives. La transition conduit donc à réinterroger les rapports au monde, aux autres et à la nature.
Nos modes de vie de plus en plus urbanisés nous ont rendus collectivement de plus en plus interdépendants et fragiles ; nous avons plus que jamais besoin de reconnaître la vulnérabilité de nos existences, de nos écosystèmes et de nos institutions, pour trouver les voies de la résilience à l’échelle mondiale. Ceci nous conduit à en explorer certaines, sous l’angle de l’éco-psychologie, de la réflexion et de la pratique éthiques, ainsi que de l’expérience spirituelle ― au sens le plus large, comme ouverture à l’intériorité et à l’altérité, dans un monde marqué par l’absurde, la violence et la souffrance, par les rapports de force et les conflits d’intérêts. La reconnaissance de nos interdépendances invite, dès lors, au discernement collectif, à la fois éthique et politique, afin d’accompagner les transformations économiques, sociales et culturelles de nos sociétés. Cette perspective est de part en part éducative, puisqu’il s’agit de nous guider les uns les autres, ensemble, afin d’emprunter, en situation d’équilibre instable, des routes viables et les plus sûres possibles, sans laisser certains en chemin…
Les sociétés contemporaines subissent plusieurs formes d’accélérations. Celles-ci sont techniques et sociales et impactent les rythmes de vie : par exemple, il nous faut deux heures pour aller en train de Paris à Bordeaux, alors qu’on mettait la journée pour faire le même trajet il y a cinquante ans. Nous pouvons communiquer gratuitement et instantanément avec des collègues, des amis ou des membres de nos familles situés à des milliers de kilomètres les uns des autres ; nous sommes débordés par la quantité de mails qui arrivent sur nos écrans et exigent de nous des réponses de plus en plus rapides… Ces accélérations peuvent être rapportées à la culture de la modernité294 et elles ont des conséquences sur notre relation à l’espace et aux milieux vivants.
L’idée du progrès induite par cette culture qui valorise l’action humaine transformatrice conduit alors à une forme de domestication, voire domination de la nature, caractéristique de la culture occidentale295. Le contrôle de l’espace et des milieux vivants s’effectue à la faveur d’une urbanisation croissante, à la fois par le biais des villes elles-mêmes à partir de leur centre historique, mais aussi par celui d’une conquête des zones périurbaines puis rurales. Autour de 55 % de la population mondiale vit aujourd’hui dans des villes… et selon les estimations, 80 % des consommations énergétiques sont associées à l’urbanisation296.
Les transformations environnementales d’origine anthropique perturbent en retour fortement le fonctionnement des sociétés humaines et nourrissent des injustices structurelles. De nombreux conflits à travers la planète aujourd’hui sont liés à l’accaparement de ressources naturelles convoitées : eau, énergies fossiles, minerais, etc. En Éthiopie, les rivalités pour l’accès à l’eau et à la terre ont nourri les conflits ethniques de ces dernières années. Parmi les pays riches en ressources naturelles, nombreux sont ceux qui sont également peu démocratiques et traversés par des inégalités énormes. Cette réalité est désignée par les chercheurs comme la « malédiction des ressources » pour les pays détenteurs de minerais rares et de pétrole, comme le Congo RDC, l’Angola ou le Nigeria297. Aux problèmes socio-économiques et politiques résultant de l’exploitation de ressources naturelles s’ajoutent les dégradations écologiques liées aux industries extractives et leurs effets sur la santé et les modes de vie, que les mesures de « responsabilité sociale des entreprises » ne traitent pas298. Les modèles d’exploitation des ressources engendrent des souffrances et des conditions de vie dégradées pour les plus pauvres et les plus vulnérables.
1. De la résilience à la transformabilité
Ces perturbations qui concernent aussi bien les êtres humains que le vivant impliquent la nécessité de favoriser des formes de résilience collective. À l’origine, la résilience désigne en physique mécanique une propriété d’élasticité et de résistance aux chocs des matériaux et, par analogie, indique dans le langage courant la résistance au changement299. Définie de manière littérale comme une « capacité à rebondir » ou à « retrouver son état antérieur », la notion de résilience est apparue dans les années 1960 et 1970 principalement dans les sciences de l’ingénieur, l’écologie scientifique et la psychologie du développement300. Toutefois, « à force d’être brandie, brassée, bradée, elle devient une sorte de mot-valise, sollicité à des fins très diverses »301. De plus, la résilience se mesure uniquement pour des perturbations clairement identifiées et se produisant dans un laps de temps court (« résilience of what to what ? »). De ce fait, la résilience des processus sur le long terme, tels que le changement climatique, est impossible à étudier, sauf dans le cas de perturbations extrêmes ponctuelles et balisées dans le temps (sécheresses, inondations, canicules). Dans ce contexte, la résilience commence à être progressivement remplacée par une nouvelle notion : la transformabilité, un terme d’origine anglo-saxonne qui n’est pas encore reconnu dans la langue française, ainsi que sa variante, la capacité transformative. Originalement vu comme une extension du concept de robustesse, d’homéostasie302 et de résilience, ce nouveau terme évoque la réorganisation des systèmes complexes après de très forts impacts provoquant un changement interne des fonctions propres. Par ailleurs, la résilience ne doit pas être pensée seulement dans les pays et les socio-écosystèmes du Sud, comme c’est souvent le cas. Elle se pense aussi à l’échelle des territoires des pays du Nord. Il s’agit de regarder autant les conditions de transformation que d’adaptation en cours dans nos pays, afin de ne pas en rester à une logique centrée sur les effets pour les plus pauvres dans les pays en développement, qui pourrait justifier l’inertie vis-à-vis des nécessaires changements de nos modes de vie. Des leviers existent à différentes échelles, et notamment via des réseaux d’acteurs à travers la planète : le mouvement des villes en transition en est un exemple303, de même que les initiatives portées aussi bien par des mouvements étudiants que par des associations ou ONG. À côté des actions concrètes, on peut se demander quel peut être le rôle de ces minorités actives304 afin de contribuer à des transformations culturelles, dans la diversité des contextes.
2. L’éco-psychologie
Nos modèles économiques et les modes de vie qui leur sont associés engendrent des souffrances liées à une hypertrophie de certaines dimensions de la personne, au détriment d’autres. L’Homo economicus maximisateur de son utilité et détenteur de besoins soi-disant infinis se heurte à ses propres limites ; ceci vaut individuellement aussi bien que collectivement. La soif d’accumulation et la recherche du « toujours plus » symptomatiques de nos sociétés sont une façon de masquer la double angoisse qui marque l’existence humaine ― angoisse de la mort et angoisse de la finitude305. Cette tendance addictive des sociétés capitalistes crée des dépendances à des modes de vie insoutenables, tout en contribuant à affaiblir et abîmer le sens du commun306. Les approches psychologiques habituelles, centrées sur la guérison et le mieux-être de l’individu comme être humain autonome, ne vont pas jusqu’à la racine des problèmes et ne prennent en compte bien souvent que des symptômes de maux qui proviennent aussi des maux structurels de nos sociétés consuméristes et égotistes, ainsi que d’un rapport mal ajusté et destructeur à la nature.
L’éco-psychologie, dont Jung307 ― par son attention au rapport structurant de l’être humain à la nature, aux grands mythes et symboles qui construisent l’être humain ― peut être considéré comme un précurseur, s’est surtout développée dans le monde anglo-saxon308. Comme le résume le sociologue Michel-Maxime Egger, « pour les éco-psychologues, la maturité […] suppose la capacité à vivre en même temps dans l’unité et la pluralité. Elle implique trois éléments complémentaires. Primo, une conscience aiguë de notre identité personnelle et de ce qui nous distingue des autres. Secundo, un sens de notre appartenance à la toile de la vie, tissée de liens avec tous les êtres vivants. L’identité n’est pas seulement l’émergence de plus en plus fine d’une singularité personnelle, mais une composition toujours plus élaborée de relations entre la personne et la multitude des autres, humains et non-humains. Tertio, une compréhension et acceptation de nos propres limites, en particulier dans les relations à la nature. Celle-ci est à la fois un partenaire et un complément fondamental de nos relations sociales, et non une réalité extérieure, un stock de ressources ou un refuge »309. Le concept de « résonance », récemment développé par Hartmut Rosa310, désigne également la recherche d’une vie ajustée à la nature et aux autres, par opposition à différentes formes d’aliénation des individus et groupes humains, notamment sous la forme de rapport au monde dépourvu de relation véritable et d’interactions signifiantes avec les autres, qu’il s’agisse de sa vie professionnelle ou de sa vie familiale, associative, etc.
3. La reconnexion au vivant par les éthiques de la nature
De nombreux courants de pensée philosophiques ont insisté sur la distinction radicale entre les êtres humains, d’une part, et le reste du cosmos et des êtres vivants, d’autre part. Kant invite à reconnaître la dignité intrinsèque de toute personne humaine qui se différencie des « choses » à qui un prix peut être conféré311. Une telle approche permet de critiquer la façon dont les êtres humains peuvent être manipulés, marginalisés, réduits en servitude, etc. Mais elle est inopérante pour combattre l’instrumentalisation de la nature et du vivant au service de logiques prédatrices et destructrices. Des « éthiques de la nature »312 ont émergé depuis quelques décennies pour mettre l’accent sur les relations entre l’être humain et la nature et considérer les devoirs moraux voire l’exigence de justice à l’égard du vivant. Elles donnent une valeur morale aux êtres non-humains : aux animaux doués de sensibilité pour les approches patho-centrées ; aux êtres vivants ― êtres humains, animaux, plantes, micro-organismes ― pour les approches bio-centrées ; aux communautés biotiques, voire à tout le cosmos pour les approches éco-centrées qui insistent sur la considération des êtres vivants pas seulement de manière individuelle mais au sein d’une totalité irréductible à ses parties313.
Toutes ces approches dénoncent l’anthropocentrisme présent dans les traditions philosophiques et religieuses occidentales. Une tension traverse néanmoins la critique concernant le dualisme qui sépare le sujet humain de la nature. S’agit-il d’inverser ce dualisme pour revaloriser le pôle de la nature ou de le dépasser pour penser l’appartenance des humains à la nature ? Les éthiques faiblement anthropocentrées, ainsi que les éthiques bio-centrées, patho-centrées et éco-centrées proposent des réponses différentes face à cette alternative, qui peuvent néanmoins être mobilisées dans leur commune intention de contribuer à susciter des pratiques respectueuses des vivants et des milieux vivants.
De ce point de vue, tous ces courants conduisent à critiquer des modes de production et de vie humains qui s’appuieraient sur l’idée d’une substituabilité des moyens permettant le développement social et économique. Ils plaident pour une « durabilité forte »314, s’inscrivant en faux contre la « durabilité faible » théorisée par l’économiste Robert Solow et inspirée par la logique utilitariste. Une forme d’utilitarisme, en effet, dans sa version centrée sur la maximisation de l’utilité, peut conduire à s’intéresser à des montants agrégés et monétarisés ; il ne tient pas compte des dégradations environnementales pouvant être liées à la création de richesse et d’utilité. En revanche, si l’on adopte la perspective de la durabilité forte, il s’agit de reconnaître les valeurs constitutives de la nature, ressources physiques, biologiques et écologiques d’un lieu. Une telle conception a des conséquences directes sur les façons d’agir et de vivre : la production de richesses n’est alors envisagée que sous condition de préserver le maintien des écosystèmes et l’intégrité vivante des milieux naturels et culturels où l’être humain habite.
4. Vers de nouveaux rapports à la nature en Occident ?
On le voit, les débats autour de la philosophie de la nature et de l’écologie aujourd’hui en occident sont tributaires de nos traditions de pensée. Comme le montre l’anthropologue Philippe Descola315, elles sont l’expression d’une vision du monde, d’une ontologie naturaliste, qui n’est qu’une vision du monde parmi toutes celles qui sont possibles. Il définit en effet quatre grands schèmes qui représentent quatre grands modes d’identification des êtres selon les ressemblances et différences entre ce qu’il dénomme les physicalités (caractéristiques physiques) et les intériorités (esprit, psychisme) : l’animisme, le totémisme, l’analogisme, le naturalisme.
Le naturalisme nous rattache aux non-humains par les continuités matérielles et nous en sépare par l’aptitude culturelle. L’animisme prête aux non-humains l’intériorité des humains mais les différencie par les corps. Le totémisme souligne la continuité matérielle et morale entre humains et non-humains. Enfin, l’analogisme postule entre les éléments du monde un réseau de discontinuités structuré par des relations de correspondances.
Ces conceptions donnent lieu à des cosmologies ― des conceptions de l’origine et de la structure de l’univers ― différentes, à des modèles divers du lien social, à des théories plurielles du rapport à soi et à l’autre, de l’identité et de l’altérité. Chacun de ces grands schèmes peut également faire l’objet de modalités diverses de relations entre les êtres, sous l’angle de l’échange, de la prédation, du don, de la production, de la protection ou de la transmission. La conception naturaliste occidentale conduit à la tentation de faire une partition entre ce qui serait rationnel ou irrationnel dans une même culture. Descola donne l’exemple d’une incantation magique au moment de la chasse chez les chasseurs achuar316 dans le bassin amazonien, en Équateur, qui peut être interprétée de diverses façons : « Elle n’est pas opératoire parce qu’elle serait performative […], elle est opératoire en ce qu’elle contribue à caractériser et donc à rendre effective, la relation qui s’établit à un moment donné entre un certain homme et un certain animal : elle rappelle les liens existants entre le chasseur et les membres de l’espèce, […] elle souligne les liens entre les parties en présence317 […] ». Cette perspective animiste va être lue comme de l’irrationalité dans une ontologie naturaliste. Mais elle traduit une certaine conception du rapport entre les êtres, qui se déploie ensuite selon des modalités de relation très diverses, les unes intrinsèquement violentes et prédatrices dans certains groupes et les autres orientées vers la coopération et la solidarité.
5. Les leviers culturels et spirituels de la transition
Dès lors, la question écologique oblige à repenser profondément les rapports entre l’être humain et la nature. Elle favorise une critique des tendances naturalistes de nos représentations, lorsque ces dernières veulent développer une vision cohérente et unifiée du monde à partir des connaissances issues des sciences de la nature. La perspective naturaliste est liée à une conception fixiste de la nature, reposant sur des constats scientifiques déconnectés de toute perspective herméneutique ou métaphysique. Une telle perspective est peu sensible à la diversité des récits et des interprétations concernant le monde, la vie, les milieux vivants, etc. Les approches sensibles aux interdépendances au sein du cosmos conduisent aussi à la critique de l’artificialisation de la nature via, par exemple, la géo-ingénierie, qui oublie les limites et ne regarde qu’un aspect partiel des problèmes à résoudre sans considérer les conséquences pour le tout.
Le questionnement éthique peut constituer un aiguillon pour mieux discerner comment dépasser les attitudes prédatrices liées à cette conception dualiste. Peut-être alors est-ce du point de vue des enjeux écologiques et du critère de la survie de l’humanité que l’on peut retrouver une convergence entre les traditions culturelles et religieuses et les sagesses de l’humanité. Celles-ci peuvent se retrouver dans un commun effort pour lutter contre la destruction des écosystèmes et pour le respect de la vie et du vivant.
Une telle perspective invite à chercher comment les sociétés peuvent mobiliser les ressources symboliques, critiques et pratiques de leurs traditions pour mettre en œuvre la mutation nécessaire des modèles économiques et des modes de vie insoutenables. Les fondements des démocraties libérales sont remis en cause et celles-ci sont en « panne eschatologique », c’est-à-dire ne se réfèrent pas à des finalités qui orienteraient nos actions collectives et en donneraient le sens : nous nous méfions des grands récits porteurs d’aspirations potentiellement totalitaires et notre insistance sur les technosciences a contribué à ce que Max Weber appelait le « désenchantement du monde »318. Dans ce cadre, la crise écologique nous place devant nos responsabilités vis-à-vis du maintien de conditions de vie hospitalières pour les êtres humains et tous les vivants dans les décennies et siècles qui viennent. Les gestes et les projets en faveur de la transition écologique, dans toutes nos sociétés, éclairent les sources et les fins éthiques et spirituelles de nos projets politiques, pouvant ainsi ouvrir des voies fructueuses pour renouveler l’engagement citoyen aujourd’hui. Il n’y a pas une seule éthique ajustée à l’écologie. Une telle éthique se cherche sous des formes diverses dans les traditions, les religions et les cultures.
Les diverses traditions de l’humanité, ouvertes à une critique interne et externe, permettent de définir, au sein de nos sociétés, une anthropologie relationnelle, ouverte à l’altérité, capable de soutenir le projet politique de la transition. Elles fournissent un double réservoir à la fois symbolique et critique. Les significations ne sont pas figées. Leur interprétation peut permettre l’invention de nouvelles formes de vie quotidienne, plus frugales et solidaires, en accord avec les exigences de la transition écologique.
Dans presque toutes les traditions spirituelles de l’humanité (judaïsme, christianisme, islam, hindouisme, bouddhisme, taoïsme, confucianisme), l’instance critique est fournie par la règle d’or : « Traite les autres comme tu voudrais être traité » ou « ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse ». Une telle règle invite à considérer l’autre comme soi-même et à envisager sans cesse les conséquences de ses propos et de ses gestes pour autrui, en se mettant à sa place. Dans sa formulation négative, elle correspond au principe « ne pas nuire ». Dans sa formulation positive, elle ouvre à une interprétation plus large de ce qui est peut-être dû à autrui. En tout état de cause, la règle d’or met au cœur de la condition humaine la qualité de la relation à l’altérité.
Aucune religion ne garantit des formes ajustées de relation à la nature, qui assurent la survie des générations futures. Des perspectives non confessionnelles peuvent puissamment contribuer à donner du sens à l’existence humaine. Néanmoins, dans un monde polarisé du point de vue des croyances religieuses, largement aconfessionnel en Occident et fortement structuré par le religieux dans les autres régions du monde, le combat commun, éthique et spirituel, pour le respect de la création et la solidarité, peut réunir des individus et des groupes de différentes confessions et convictions, au-delà des frontières.
6. Comment se projeter dans l’avenir ?
Comment se projeter dans l’avenir, alors même que celui-ci est marqué par une incertitude radicale, par des risques et des menaces pesant sur la survie d’une partie de la population mondiale ? La référence à l’Apocalypse319 fut présente dans la réflexion des penseurs comme Günther Anders, Karl Jaspers ou Hans Jonas : l’ère de la bombe atomique signerait une entrée dans le temps de la fin, marqué par la possibilité humaine inédite d’une guerre totale et d’un anéantissement de l’humanité. Elle est fréquente aujourd’hui, pour décrire le chaos à venir si nos sociétés continuent sur leurs courses folles ― extractivistes, productivistes et consuméristes. Ces perspectives sont particulièrement présentes chez celles et ceux qui font référence à la collapsologie, l’étude de l’effondrement.
La collapsologie a gagné beaucoup de force dans les pays occidentaux, et notamment en France ces dernières années. Elle a été définie par Pablo Servigne et Raphaël Stevens comme « l’exercice transdisciplinaire d’étude de l’effondrement de notre civilisation industrielle, et de ce qui pourrait lui succéder, en s’appuyant sur les deux modes cognitifs que sont la raison et l’intuition, et sur des travaux scientifiques reconnus »320.
Ce mouvement est pluriel et suscite différentes interprétations. Certains envisagent un effondrement dans un horizon temporel proche et considèrent qu’il est déjà trop tard pour inverser les trajectoires mortifères de nos sociétés. Une telle approche rencontre l’objection selon laquelle ce catastrophisme peut conduire tout autant à des stratégies de repli sur soi, à une inertie collective et au déferlement de passions égocentrées, qu’à des initiatives pour anticiper des désastres en chaîne et pour s’y préparer (cf. supra à propos de la résilience). Plusieurs écrits soutiennent une conception anthropologique et ontologique mettant au premier plan les ressources de solidarité et d’entraide inhérentes aux êtres humains321. Cette prise de position s’inscrit en faux contre une vision marquée par le primat accordé à la concurrence et à la compétition dans les rapports humains.
Une critique forte à l’égard de la collapsologie serait d’une part son manque de fondement et de certitude concernant la dynamique d’effondrements à venir322 et d’autre part son caractère largement apolitique. Face à ces critiques, la perspective défendue par de nombreux penseurs de la collapsologie tient au souci de montrer que d’autres formes de vivre ensemble, de projets de sociétés, de modèles économiques et d’attitudes existentielles, sont possibles323, et qu’il s’agit de se situer à la fois en rupture ou aux interstices des modes de vie actuels324. Une autre perspective consiste à se situer au niveau des institutions existantes pour tenter de voir quelles réformes apporter pour réorienter le plus possible les trajectoires existantes, flécher les investissements vers les secteurs décisifs pour soutenir la transition écologique et soutenir/compenser les populations les plus menacées.
Dans tous les cas, ces réflexions et les actions qui en découlent renvoient les citoyens à leurs responsabilités collectives et pas seulement individuelles. La question se pose de savoir comment se projeter mentalement aussi bien dans la catastrophe possible et probable325 que dans l’horizon désirable326 afin de réfléchir aux étapes nécessaires pour éviter les catastrophes ou réduire leur ampleur, et faire advenir le futur souhaitable.
7. Les enjeux du discernement collectif
Nous utilisons le terme de discernement, issu du terme grec krisis : le jugement, et du latin discernere : séparer. Il s’agit, dans ses deux premières acceptions, de l’action de distinguer, de discriminer et de la faculté d’apprécier sainement les choses. Le terme est utilisé dans une perspective éthique et spirituelle, comme exercice d’une pensée critique et, pour certaines religions, notamment dans la tradition chrétienne, comme recherche à la fois active et réceptive de la volonté de Dieu à l’œuvre dans la contingence de l’Histoire327. Dans une perspective non-confessionnelle, le discernement est une démarche qui concerne à la fois l’analyse d’une situation, la formulation d’une question ou d’un problème méritant un jugement et une décision, la mise en œuvre d’un processus de délibération sur cette question et la décision finale.
Un processus individuel et collectif de discernement est nécessaire, en vue de décisions communes pour mettre en œuvre la transition écologique et sociale. L’exercice du discernement à une petite échelle peut aussi exercer les citoyens à des discernements à plus grande échelle et, ainsi, alimenter la recherche des conditions de démocraties écologiques (voir Nomos).
Dans des contextes sociaux marqués par des injustices, des inégalités et des rapports de force, la perspective libérale cherche à faire en sorte que tous puissent participer à des délibérations favorisant des décisions qui reflètent des avancées vers un plus juste partage des ressources ou une meilleure contribution au bien commun, au bien de chacun. Rappelons qu’il faut trois conditions pour une décision collective : 1) un corps délibérant : « un collectif organisé d’individus, animés par une intention, et dont les cours singuliers d’action sont orientés, par désir ou par devoir, vers une action commune, celle-ci rendant nécessaire la sélection d’un choix commun d’action »328 ; le corps délibérant peut-être solidaire, ou mandaté ; 2) l’impossibilité d’opérer un choix séparé : il faut entrer dans ce qui a été décidé ; 3) une procédure appropriée d’examen et de sélection d’options, avec un travail décisionnel.
Se pose la question des méthodes les plus adaptées à des décisions orientant les comportements collectifs, à différentes échelles. Insister sur la délibération est une manière de dire l’importance de l’analyse et de l’échange d’arguments. C’est reconnaître la condition humaine interdépendante et dénoncer l’illusion folle d’une toute-puissance surplombante qui viendrait dicter des choix collectifs. Toutefois, différents problèmes se posent : les processus effectifs de délibération (entendus au sens large) ne sont pas les processus idéaux. Ils sont souvent le fait d’une partie de la population (par exemple les débats nationaux sur certains sujets mobilisent une majorité d’hommes blancs d’un certain âge et avec une bonne éducation) ; tout le monde n’a pas la même capacité à donner des arguments ; de multiples biais existent. De plus, les processus sont souvent liés à une perspective qui repose sur l’agrégation de décisions individuelles : il n’est pas sûr qu’ils puissent prendre en compte des éléments relatifs à des appartenances collectives. De surcroît, il n’est pas garanti que la confrontation des intelligences individuelles produise de l’intelligence collective.
Il faut également être attentif à beaucoup d’effets de groupe : la dilution de la responsabilité, la paresse sociale, les effets informationnels/cognitifs, l’effet de contamination, le biais de négativité ou d’optimisme ; et les biais de raisonnement329. Par exemple, la faible mobilisation des pouvoirs publics français au début de la crise du COVID-19 peut être en partie expliquée par le précédent de la crise du SRAS en 2002-2003 : l’achat de masques avait été beaucoup trop important au regard de l’épidémie et avait donc eu un coût important en termes de santé publique. Enfin, les engagements sociétaux et politiques qui favorisent une transformation des structures ne sont pas seulement liés à de bons processus de dialogue ; ils mettent en jeu de multiples dimensions du vivre ensemble, et des passions individuelles et collectives.
Dès lors, comment favoriser des démarches collectives adaptées à ces transformations institutionnelles ? Certains critères relatifs aux finalités de la transition écologique et sociale peuvent orienter ces démarches : a) le souci de reconnaître les responsabilités collectives330 ; b) la recherche de l’émancipation individuelle et de l’empowerment collectif331 ; c) l’objectif de l’empowerment des plus vulnérables à toutes les étapes du processus332, 333, et l’objectif final d’une possible participation de tous à des structures plus justes.
8. Une vision de l’éducation à la transition
La transition écologique et sociale suppose une éducation collective, et des approches éducatives renouvelées concernant aussi bien l’éducation formelle que l’éducation citoyenne, au long de la vie334.
La vision large présentée dans cet ouvrage consiste à promouvoir une éducation qui permette à chacun d’accomplir son chemin unique dans le partage et la contribution à une communauté de destin. Elle est ancrée dans une conception relationnelle qui considère que chaque personne est unique et en relation, immergée dans des milieux vivants naturels et culturels, au sein du cosmos.
Nous en déduisons différents axes et compétences pédagogiques, qui correspondent aux six portes de ce socle commun :
- formation à la pensée systémique (oikos)
- éthique et responsabilité (ethos)
- changement des modèles mentaux (nomos)
- vision partagée et récits (logos)
- apprenance et action collective (praxis)
- présence à soi et reconnexion aux autres (dynamis)
Les six portes du Manuel visent à définir à la fois des connaissances, des compétences, des manières de procéder reliées à des principes et à des attitudes. Elles peuvent être rapprochées, du point de vue de la recherche pédagogique en vue de transformations de nos institutions et de nos modes de vie, de différents travaux réalisés ces dernières années dans diverses enceintes, notamment au plan international par l’Unesco, pour promouvoir l’éducation en vue du développement durable335, en France par la Conférence des Grandes Écoles et la Conférence des présidents d’université (CGE/CPU) à travers le « Guide de compétences développement durable et responsabilité sociétale, 5 compétences pour un développement durable et une responsabilité sociétale »336 ; et aux États-Unis et de manière élargie, par Peter Senge qui invite à considérer 5 disciplines (selon l’étymologie latine disciplina : apprentissage337).
