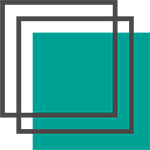
1. Vivre bien avec et pour les autres dans l’Anthropocène
1.1. Le souci des autres
Les bouleversements environnementaux, locaux et globaux, exposent à des risques l’ensemble des habitants humains et non humains de la Terre. Face à un tel changement, nous nous découvrons « tous vulnérables »131, dans une situation d’interdépendance généralisée. La portée spatiale et temporelle du changement climatique instaure en quelque sorte une communauté de fait entre toutes les victimes potentielles de ce réchauffement. Cette communauté reste cependant négative au sens où elle n’implique pour les individus aucun autre attribut que celui d’avoir en partage le fardeau climatique et environnemental. Ainsi l’interdépendance généralisée fait apparaître, dans l’espace ouvert entre cette communauté négative et les communautés de droits que sont les États, un ensemble d’êtres que l’on pourrait décrire comme les exclus du monde commun132. Parmi ceux-ci, trois groupes sont tout particulièrement concernés : les vivants non humains, les générations futures et les migrants.
1.1.1. Les êtres vivants non humains
Le bilan négatif pour le monde vivant non humain des deux derniers siècles du développement des sociétés humaines est sans équivoque. Les sources de cette dégradation du monde vivant sont multiples : politiques, sociales, économiques et culturelles. Sur le plan politique, les fondations théoriques des sociétés modernes ont historiquement exclu le reste du vivant des communautés politiquement instituées. Cette exclusion des non-humains de la sphère politique a pu s’accompagner de leur mise à l’écart de la communauté éthique et donner lieu à une forme d’« anthropocentrisme moral »133. Cette expression qualifie des théories morales qui dessinent un partage net entre les humains et le reste du vivant, un partage dont Emmanuel Kant tracera la ligne claire en affirmant que seuls les êtres humains ont une valeur intrinsèque et comptent pour eux-mêmes134. Cet humanisme exclusif à l’égard des autres êtres vivants, renvoyés à leur seule valeur instrumentale, a justifié la thèse selon laquelle les humains ne sont tenus à des devoirs de justice qu’à l’égard d’autres humains.
1.1.2. Les générations futures
Au-delà des générations actuelles, la longue durée des transformations en cours étend le souci des autres aux générations futures qui subiront les effets des actions présentes et passées135. De façon générale, l’introduction de cette préoccupation pour le futur pose les questions du type de legs qui doit être transmis par une génération à une autre et des conditions sous lesquelles cette transmission respecte bien un devoir de justice intergénérationnelle. Contre l’hypothèse de la substituabilité des ressources naturelles par des capitaux physiques ou humains, une conception forte de la durabilité impose que soit transmis aux générations futures un stock réel de ressources naturelles leur permettant de satisfaire à leurs besoins136.
1.1.3. Les migrants
Les bouleversements environnementaux sont à l’origine de migrations de populations aux échelles locale, nationale et transnationale137. Les causes de ces migrations sont multiples : inondations, sécheresses, feux, vagues de chaleur, ouragans, montée des eaux, etc. Ces différents phénomènes peuvent priver temporairement ou durablement des populations de l’accès à des biens fondamentaux qui leur permettent normalement de se nourrir, d’avoir accès à une eau potable ou de se loger, et les contraindre à migrer vers d’autres régions. Ces déplacements de population ont déjà pu être observés : selon certaines estimations environ 25 millions d’individus auraient déjà migré pour des raisons climatiques au début des années 2000138. Ils sont amenés à s’intensifier fortement à mesure que se poursuit le réchauffement climatique. Si les évaluations restent incertaines, le nombre de 200 millions de migrants climatiques en 2050 est cependant fréquemment avancé dans différents articles et rapports officiels139.
Cette situation donne naissance à des obligations morales et politiques à l’égard des migrants environnementaux. Au-delà du seul devoir éthique d’hospitalité140, la reconnaissance des droits politiques de ces migrants relève d’une exigence de justice environnementale et climatique141, 142, 143.
1.2. Le souci du monde
La compréhension des enjeux environnementaux a vu naître des expressions variées d’un souci éthique pour le monde. Des états de vie « reliés » au monde ont en particulier pu être formulés par des peuples autochtones. Ainsi, l’expression kichwa Sumak Kawsay, traduite en espagnol par le Buen vivir, réfère à l’idée d’une vie digne, équilibrée, heureuse et harmonieuse avec la nature144. Cela rejoint l’ensemble des cosmologies fondées sur le respect de la Terre-mère, la Pachamama en Amérique du Sud. Pour les Mapuche, peuple originaire des confins du Chili et de l’Argentine, le Küme Mongen représente une vie épanouie en harmonie avec les humains et l’environnement. Le peuple Nishnaabeg, l’une des plus importantes Premières Nations du Québec, parle quant à lui de mino bimaadiziwin pour désigner une vie bonne, socialement et écologiquement145. Enracinés dans une conception systémique de la vie et de l’intégration des humains dans leur environnement, ces divers concepts se présentent comme des alternatives philosophiques aux concepts portés par l’Occident que sont le développement (même durable) et les politiques économiques qui l’accompagnent.
Le détour par les pensées des peuples autochtones, enfin, permet de sortir du préjugé ancien que les pays en voie de développement seraient demain les plus gros pollueurs, car trop préoccupés par leur propre développement économique — ou leurs conditions de survie — pour se soucier de leur environnement, par opposition aux pays développés qui seraient aujourd’hui les plus « respectueux » du monde146. La pensée éthique, au contraire, se manifeste aussi bien dans la philosophie occidentale classique que dans la philosophie des peuples autochtones. En ce sens, elle représente bien une manière de « faire du lien » et d’unir nos efforts en vue d’un soin global pour le monde.
1.3. Le souci de soi
Le contexte environnemental et social de l’Anthropocène soulève également des interrogations sur le sens que peut prendre la quête d’une vie éthique. Une vie éthique est-elle possible dans le contexte de l’Anthropocène ? Cette question réactualise dans le contexte des bouleversements environnementaux le problème posé en 1944 par le philosophe allemand Adorno147 : comment mener une vie bonne dans une vie mauvaise, c’est-à-dire dans un monde structuré par l’inégalité et l’exploitation de vies humaines et non humaines ?
Parmi la diversité des théories morales pouvant éclairer la prise de décision, les éthiques des vertus visent à décrire les traits de caractère ou les dispositions à agir que devraient cultiver les individus qui aspirent à mener une vie éthique. Dans le contexte actuel, ces dispositions sont définies pour partie pour répondre à des enjeux environnementaux et peuvent donc être décrites comme des « vertus écologiques ». Parmi ces dernières figureraient la sobriété, la capacité à coopérer, l’attitude de respect à l’égard de la nature148.
La conduite de la vie bonne pour soi est dans le même temps indissociable des formes sociales dans lesquelles elle prend place. En ce sens, la vie morale est avant tout une vie sociale qui se déploie au sein d’institutions formant une totalité éthique qu’il faut examiner. C’est pourquoi la quête de la vie éthique commence par le regard porté sur les vies déconsidérées, celles qui semblent ne pas compter dans la société ou qui évoluent dans la « pénombre de la vie publique ». De ce point de vue, la conduite morale dans l’Anthropocène consiste en premier lieu à s’employer à révéler les nouveaux visages de la précarité, nés des bouleversements environnementaux et sociaux, ainsi qu’à refuser de prendre part aux formes sociales qui conditionnent ces vies précaires.
2. Injustices environnementales et responsabilité
2.1. Injustices environnementales
La dégradation des milieux de vie des humains intensifie les inégalités déjà existantes en frappant plus fortement de façon générale les individus et les populations les plus pauvres. Ce constat a donné naissance à l’apparition d’un mouvement en faveur de la justice environnementale149. Dans plusieurs régions du monde, depuis les quartiers défavorisés des grandes villes américaines aux campagnes de certains pays du Sud, des mouvements se sont, en effet, soulevés depuis les années 1980 pour dénoncer la façon dont la crise environnementale pesait de façon particulièrement lourde sur les populations les plus pauvres150.
Le changement climatique est plus spécifiquement la cause d’une double injustice : ce sont les populations qui ont le moins contribué à ce changement qui en subissent et en subiront les effets les plus néfastes151. Dès 1992, les parties réunies à Rio au sommet de la Terre avaient énoncé dans la convention-cadre sur le climat le principe d’une responsabilité commune, mais différenciée :
« Le caractère planétaire des changements climatiques requiert de tous les pays qu’ils coopèrent le plus possible et participent à une action internationale, efficace et appropriée, selon leurs responsabilités communes mais différenciées, leurs capacités respectives et leur situation sociale et économique »152.
Néanmoins, il restait encore, et il reste toujours à lui donner un contenu, c’est-à-dire à établir en pratique ce que serait une répartition juste des coûts associés à l’atténuation et à l’adaptation au changement climatique, prenant en compte la dette écologique des pays du Nord à l’égard des pays du Sud153.
2.2. Enjeux de l’écoféminisme
Le changement global pèse localement plus fortement sur les femmes et renforce donc les inégalités de genre. Ce problème est au cœur du développement du mouvement et du courant de pensée de l’écoféminisme154. Forgé en 1974 par la féministe française Françoise d’Eaubonne155, le terme désigne les convergences de pensée et de luttes féministes et écologistes. Diversifié, le courant s’est attaché de façon générale à mettre en avant les liens historiques entre la domination des femmes et de la nature. Ces dominations croisées prennent concrètement forme en particulier dans la sphère des activités quotidiennes visant à assurer la subsistance, le chauffage, l’éducation, soit l’ensemble des activités de maintien et de réparation du monde, comme l’indique la philosophe Joan Tronto dans son livre Un monde vulnérable (2009). Cette configuration historique expose plus fortement les femmes aux risques environnementaux, notamment ceux qui sont liés au changement climatique : exposition à la chaleur, hypothermie, maladies liées à l’eau durant des épisodes météorologiques violents156. En outre, parce qu’elles sont majoritairement en charge des activités de soin pour les jeunes enfants et pour les personnes âgées, elles font face aux difficultés et aux violences liées à la nécessité de se déplacer ou de migrer pour échapper aux désastres environnementaux.
2.3. Inégalités linguistiques
S’il faut sans aucun doute repenser les conditions de la composition d’un monde commun pour faire face aux changements globaux, cela ne saurait se faire sans veiller aux différentes formes de domination culturelles et linguistiques que cette construction pourrait produire. La diversité linguistique est reliée de plusieurs manières aux bouleversements environnementaux en cours. Elle l’est de façon originaire par les liens malheureux qui unissent ces phénomènes à l’impérialisme colonial, qui fut et continue à être la principale cause historique de domination linguistique157. Le monde post-colonial reste structuré par des inégalités de traitement des différentes langues du monde. Ces inégalités se reproduisent au sein de diverses institutions locales, nationales et internationales. Or la diversité des langues renvoie à un répertoire de pratiques qui indiquent d’autres manières de se lier au monde ou au vivant et d’en prendre soin. Les défenses des « points chauds » de la biodiversité et de la diversité linguistique concourent fréquemment à la protection des mêmes territoires158. La défense de la diversité des langues rejoint ainsi les luttes pour la survie de la pluralité menacée des manières d’habiter la Terre.
2.4. Repenser la responsabilité
Pour appréhender les changements globaux, la notion de responsabilité doit être redéfinie sur plusieurs versants : l’extension de sa portée morale à de nouvelles actions, l’articulation entre les niveaux individuels et collectifs, la responsabilité pour le passé et pour le futur. Cette refonte est déjà amorcée dans le domaine du droit. Définie généralement comme le devoir de répondre des effets dommageables d’une action ou d’une inaction, la responsabilité sur le plan juridique suppose l’existence d’une règle de droit dont le non-respect implique une sanction ou l’obligation d’indemniser. Que la responsabilité soit civile, pénale ou encore administrative, elle suppose l’imputabilité de l’acte. Or cette définition semble être mise à l’épreuve, dans un contexte de mondialisation et de globalisation économique marqué par des interdépendances et des risques globaux où les dommages sont collectifs et dépassent les frontières159.
Différentes dimensions de la responsabilité doivent ainsi être prises en compte. Catherine Thibierge, affirmait que « tout comme la responsabilité civile s’est détachée de la responsabilité pénale, une nouvelle responsabilité juridique pourrait aujourd’hui se détacher de la responsabilité civile, permettant la création d’une action préventive des risques d’atteintes majeures à un intérêt essentiel de l’humanité »160. Trois verbes étaient alors employés : punir, réparer et prévenir, qui traduisaient trois fonctions de la responsabilité juridique déclinée en responsabilité pénale / civile ou administrative / « universelle ». Cette dernière concerne la responsabilité de chacun pour la « durabilité » du genre humain.
A côté de l’aspect temporel, une dynamique de solidarité doit également avoir des incidences sur la responsabilité juridique en matière environnementale161. La responsabilité doit être partagée entre États, et différents acteurs de la mondialisation : entreprises, organisations internationales, sociétés civiles, organisations non gouvernementales et citoyens, en fonction du pouvoir exercé et des risques qu’elles engendrent.
3. Quelles sociétés désirables ?
Loin de se réduire à des conceptions privées de la vie bonne, l’éthique est aussi la visée d’une forme juste de la vie collective. Elle est, selon la définition de Ricoeur, « le souhait d’une vie accomplie – avec et pour les autres – dans des institutions justes »162. La construction des valeurs qui contribuent à la définition de la vie bonne est étroitement liée aux formes sociales dans lesquelles elle prend place. Ces formes sociales se façonnent pour partie par le biais des réorganisations successives des activités productives et reproductives au sein de la société. Les penseurs se sont divisés sur le rôle et l’importance respective des valeurs, ou plus généralement des idées, d’un côté, et, de l’autre, des transformations matérielles de l’appareil productif dans l’histoire des transformations sociales. Schématiquement, cette division est basée sur l’opposition, héritée du XIXe siècle, entre des conceptions « idéalistes » et « matérialistes » de l’histoire. Ce cadre a donné lieu à des interprétations monolithiques de la modernité occidentale. Les premières la décrivent sous l’angle d’une histoire des révolutions politiques, fondées sur l’émergence des valeurs « modernes » (la liberté individuelle, l’égalité, la propriété, etc.) qui se cristalliseraient dans les droits subjectifs. Les secondes mettent en avant les transformations matérielles, les innovations techniques et les « transitions énergétiques », qui font de la modernité un moment historique de basculement entre deux régimes métaboliques : un régime agraire fondé sur l’exploitation de la terre et lié à l’énergie de la biomasse ; un régime industriel ou minier, marqué par l’accès à une énergie peu chère et en apparence illimitée. La séparation de ces deux histoires a constitué un obstacle à la compréhension de l’entremêlement des processus politiques, économiques, sociaux, techniques, culturels et écologiques constitutifs de la ou plutôt des modernités. Depuis la fin du XXe siècle, le champ interdisciplinaire des humanités environnementales163 s’efforce de les réunir pour essayer de comprendre comment les sociétés modernes se sont constituées en suivant une double aspiration à l’aisance matérielle et à un idéal politique de liberté individuelle164.
Les démocraties libérales ont pris forme sur le fond d’une métaphysique de l’illimitation du monde. Elles sont fondées sur l’hypothèse que nous vivons dans un monde non fini, dont les ressources sont supposées être illimitées, ce qui ouvrirait la possibilité que les aspirations, les désirs des individus soient également illimités. Les liens entre le développement des sociétés démocratiques au XIXe siècle et l’accès aux énergies fossiles ont fait ces dernières années l’objet de nombreux travaux. L’historien Timothy Mitchell, par exemple, a ainsi soutenu que les régimes démocratiques contemporains dépendent du charbon et du pétrole et en présupposent l’accès165.
De ce point de vue, la fin de l’abondance, imposée par la nécessité de réinscrire les systèmes économiques dans les limites planétaires, représenterait un défi majeur pour les démocraties. Voyant leurs fondements matériels se dérober sous leurs pieds, les démocraties devraient se réinventer en abandonnant leur moteur productiviste alimenté par une énergie abondante et bon marché. Dès les années 1970, des auteurs évoquent la « tâche herculéenne » qui attend les démocraties face à ce qu’ils décrivent comme un retour de la rareté166. Cette tâche appelle une rupture avec les présupposés modernes qui associaient la liberté à l’illimitation. Elle ne peut néanmoins se contenter d’en appeler à des formes sociales pré-modernes dans lesquelles les besoins humains étaient limités par nécessité. Pour autant, la désarticulation du lien entre la liberté et l’abondance pourrait bien s’appuyer sur le réinvestissement de la critique écologique des « besoins artificiels »167 créés par les sociétés productivistes et consuméristes. De la critique menée par Henry David Thoreau des besoins superflus dans la société américaine de la fin du XIXe siècle168 à la défense par André Gorz d’une « norme du suffisant »169, cette voie pourrait incarner une issue démocratique à la fin de l’abondance. Elle trouve un regain d’intérêt aujourd’hui à travers de multiples initiatives locales destinées à favoriser l’expérience de formes de sobriété volontaire.
3.1. Équité, limites écologiques et pacte avec la nature
S’il faut défaire les attelages de valeurs qui ont arrimé l’émancipation sociale à l’exploitation des ressources naturelles, la grande transition écologique et sociale n’implique pas de rejeter l’ensemble des valeurs modernes. Il s’agit plutôt de les réinsérer dans la construction collective d’un projet de société écologiquement et socialement désirable. Dans ce nouveau contexte environnemental, l’éthique pourrait être définie comme le souhait d’une vie accomplie – avec et pour les autres – dans des institutions justes170 et dans le respect des limites écologiques.
Cette réflexion sur les nouvelles définitions d’une société juste ne peut par ailleurs faire l’économie d’une réflexion sur la place qu’elle accorde aux êtres vivants non humains. Quel modèle d’organisation sociale et politique pouvons-nous inventer ou redécouvrir pour mieux cohabiter avec les non-humains ?
Avec la publication en 1992 de son essai, Le Contrat naturel, Michel Serres fut le premier, en France, à soutenir explicitement que la crise écologique globale mettait en cause le pacte social fondateur des sociétés modernes. Cette crise révélait en pleine lumière la façon dont celui-ci ne tenait pas compte de la puissance d’agir de la nature et de ses effets sur les sociétés humaines. Selon lui, la non-reconnaissance de la participation active de la nature au processus de co-construction du monde s’accompagnait d’une « violence objective » faite à la nature, qui se retournait finalement contre les humains. De ce retournement, l’historien et politiste Achille Mbembé a récemment donné une analyse plus différenciée sous le nom de « brutalisme »171, tout en soulignant lui-aussi l’intensité inédite de cette violence.
La reconnaissance de l’altérité agissante de la nature a trouvé récemment de solides appuis dans les théories de l’autonomie relationnelle, portées notamment par les critiques féministes de l’individualisme libéral172 et par les théoriciennes du care173. Ce cadre conceptuel remet au centre les relations d’interdépendance qui lient humains et non-humains. Il permet également de penser la « domination de la nature » sous l’angle de l’introduction d’un déséquilibre dans les relations de dépendance. Cette conception donne un nouvel horizon à la pensée écologique, qui n’est ni celui de la déliaison, ni celui de la domestication progressive du monde, mais se définit plutôt comme la recherche de manières interspécifiques d’habiter la Terre en commun174.
La pandémie liée au coronavirus SARS-CoV2 qui a frappé le monde en 2020 remet en cause les rapports qu’entretiennent les humains avec la part non-humaine du monde sous différents aspects. Son hypothétique origine animale, sa transmission mondiale, la distanciation sociale qui s’en est suivie posent la question des différents équilibres dynamiques qui peuvent s’instaurer ou se rompre entre les vivants humains et non-humains. La déstabilisation du monde provoquée par la pandémie invite à introduire dans le débat public des points aveugles de la mondialisation que la pensée écologique cherche à mettre en avant depuis des décennies : la massification des mauvais traitements infligés aux animaux dans le monde, le rétrécissement de la place accordée aux êtres sauvages ou encore la fragilité d’une interdépendance humaine globalisée et coupée de ses attachements terrestres. La quête individuelle et collective de la vie éthique dans le « monde d’après » passera par leur examen.
