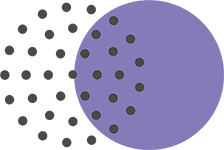
Les transitions économiques, écologiques et sociales impliquent de repenser en profondeur les objectifs de développement. La poursuite de ces objectifs requiert la mobilisation de nouveaux savoirs, issus notamment de modèles dont il faut analyser les métriques et les indicateurs : nos manières de créer des richesses, de mesurer ce qui est supposé nous permettre de vivre bien et durablement ensemble. De nombreuses recherches existent pour produire de nouveaux indicateurs de développement, pour faire évoluer les règles du jeu économique et financier, pour promouvoir des institutions et des modèles de gouvernance adaptés au nouveau régime climatique et environnemental.
1. Quelles métriques ? Quels indicateurs ? Quels modèles ?
Les modélisations qui prennent en considération la dynamique non-linéaire de nos économies, la complexité du social ainsi que l’incertitude radicale qui pèse sur les décisions prises par une vaste majorité d’acteurs, doivent être promues et enseignées.
La mise en avant d’indicateurs de performance destinés à mesurer l’efficacité d’une mesure, d’un dispositif ou encore d’une entreprise en matière de création de richesses, de rendement et/ou de productivité possible, conduit à oublier les sous-jacents naturels et humains, les écosystèmes et les personnes concernés par ces activités. On observe un réductionnisme qui confond ce qui compte avec ce qui est quantifié et conduit à l’actuelle gouvernance par les nombres175. Cette vision est devenue si dominante qu’elle a imposé comme critère de réflexion sur le bon fonctionnement des institutions publiques les seules logiques marchandes.
La croissance est le plus souvent présentée comme condition de développement humain et érigée comme un dogme non discutable176. La croissance invoquée par les décideurs économiques et politiques fait référence à l’augmentation du produit intérieur brut (PIB), c’est-à-dire des richesses produites à l’intérieur d’un territoire. Le calcul du PIB est lui-même l’objet de discussions : il ne reflète pas, en effet, l’ensemble des richesses engendrées par l’activité humaine ; par exemple, il ne prend pas en compte les activités non monétaires et non marchandes comme le travail domestique réalisé à l’intérieur des foyers.
Des marchés incapables de prémunir les sociétés contre les risques financiers et écologiques
De surcroît, une telle conception de la croissance est adossée à l’illusion d’une mise à disposition indéfinie des ressources planétaires177, au sein de marchés supposés allouer efficacement les ressources et le capital. Les marchés ont pour fonction de gérer l’allocation des capitaux financiers et de transférer les risques au sein de nos économies. L’épargne des ménages est collectée par les opérateurs financiers et est redistribuée sous forme d’investissement et de crédit. Il s’agit de transférer des capitaux de ceux qui en possèdent vers ceux qui en ont besoin pour développer des projets et des entreprises divers. Ceux qui utilisent les capitaux sont supposés les faire fructifier et les retourner à leurs propriétaires initiaux ; ils leur versent un intérêt ou partagent une partie de la richesse produite. Les risques relatifs aux activités économiques sont portés par ceux qui acceptent contre rémunération de les assumer. Les marchés financiers jouent donc un rôle important dans nos sociétés ; encore faut-il que leur soient imposés un certain nombre de règles. A l’heure actuelle, la valorisation des actifs par les mathématiques financières est incapable de produire un « juste prix » qui reflèterait la valeur économique des actifs sous-jacents aux dérivés échangés sur les marchés.
Le bon fonctionnement des marchés suppose donc leur régulation178. Quels peuvent en être les principes directeurs ? Pour reprendre la terminologie introduite par Mark Carney179, ancien gouverneur de la Banque d’Angleterre, les risques financiers induits par le fonctionnement actuel des marchés financiers, en lien avec la crise environnementale, sont de trois natures : ce sont des risques physiques, par exemple les dégâts causés par des intempéries extrêmes, des risques de transition liés notamment à la perte de valeur des actifs carbonés, et des risques en termes de responsabilité juridique. La « tragédie des horizons », selon l’expression utilisée par Mark Carney, est liée aux effets systémiques d’une dépréciation massive et généralisée des titres des secteurs carbonés qui se manifesteraient à court terme sous forme d’une crise financière systémique alors que les effets des politiques publiques sur le climat ne se feront sentir que dans plusieurs dizaines d’années. Ces trois directions de risque physique, de transition et juridique peuvent fournir les priorités d’une régulation intelligente des marchés financiers destinée à favoriser la prise en considération de ces trois types de risques.
De nouvelles métriques et de nouveaux modèles sont nécessaires afin de faire converger les logiques financières et extra-financières. L’enjeu est de promouvoir une approche de la prospérité comme capacité d’épanouissement plutôt que comme opulence matérielle ou utilité mesurée par le PIB. Parler de capacité fait référence à une conception du développement humain mise en avant par l’économiste Amartya Sen180, par la philosophe Martha Nussbaum181 et par d’autres chercheurs en sciences sociales depuis les années 1990. Il s’agit de considérer les capacités182 des individus et des groupes « à faire et à être », les ressources nécessaires pour qu’une personne puisse traduire ses potentialités en réalisations effectives, ainsi que les droits d’accès des personnes à de telles réalisations dans leur société politique. Par exemple, si un enfant a les capacités physiques et intellectuelles pour aller à l’école, en a-t-il les moyens logistiques et financiers, et en a-t-il le droit d’accès ? Une telle perspective relie une interrogation sur les choix des personnes dans différentes dimensions de leur existence, et un questionnement politique sur l’aptitude des institutions à créer les conditions du déploiement de ces capacités. Une telle approche renvoie aussi à un autre modèle économique, non plus fixé sur la propriété et les résultats d’une production matérielle, mais sur les fonctions et les services, comme le proposent différentes formes de l’économie de la fonctionnalité et des services.
Différents indicateurs ont été proposés à l’échelle internationale depuis une trentaine d’années : le PNUD a notamment contribué à diffuser l’Indicateur de Développement Humain (IDH), inspiré par les travaux de Sen (qui comprend le PIB par habitant, l’espérance de vie à la naissance, le taux de scolarisation à l’école primaire et le taux d’alphabétisation des adultes), puis l’Indicateur de Pauvreté Multidimensionnelle, qui remplace la valeur monétaire du PIB par habitant par des données relatives au niveau de vie matériel des personnes.
Un défi important est de faire reconnaître à tous les niveaux l’importance des indicateurs qui façonnent nos manières de nous représenter le monde, la vie désirable, et ce qui compte vraiment dans nos sociétés.
Des visions renouvelées de la production et du partage primaire des richesses créées peuvent se décliner en choix d’investissement, en règles fiscales183, en normes comptables internationales et en règles prudentielles qui encadrent l’activité bancaire. Le sujet des normes comptables est décisif, puisque la comptabilité détermine la manière dont des projets et activités vont être considérés comme rentables, pérennes, etc. Une des recommandations du rapport Sénard-Notat en préparation de la loi PACTE de 2019 en France mentionne que « la comptabilité strictement financière ne donne pas une image fidèle de la pratique des entreprises »184.
Des propositions diverses ont vu le jour afin d’intégrer de façon structurante, dans la durée, les effets de l’activité sur ses écosystèmes naturels et humains. Il s’agit de transformer le rapport comptable à la nature conçue par l’être humain comme un actif à exploiter à sa guise, et pour inscrire dans la comptabilité le coût de maintien du capital naturel et du capital humain185.
L’intervention publique en matière climatique et environnementale peut se décliner en trois ensembles : des réglementations, notamment pour fixer des normes d’émission ; des taxations pour intégrer dans la valeur marchande le coût des externalités sociales et environnementales ; et un marché du carbone qui consiste à échanger des droits d’émission avec un prix qui doit augmenter substantiellement le coût des activités émettrices.
L’instauration d’une fiscalité carbone est sans doute l’élément prioritaire de la régulation nécessaire186. Les simulations macroéconomiques montrent que pour parvenir à infléchir les émissions de gaz à effet de serre et conserver quelque chance de ne pas trop nous éloigner du seuil des +2 °C de réchauffement à la surface de la planète en fin de siècle, le niveau des taxes carbone nécessaire est de l’ordre de 300$/tonne avant 2030187.
La réforme des normes comptables mentionnée précédemment joue un rôle clé dans la recherche d’un réencastrement de l’économie dans un projet de société, dans le respect des milieux vivants. Cela conduit aussi à analyser l’évolution des conceptions de l’entreprise et de ses responsabilités depuis deux siècles188.
Une perspective citoyenne de la responsabilité sociale de l’entreprise consiste à prendre la mesure des enjeux écologiques et sociaux actuels et à subordonner l’activité de l’entreprise au maintien des conditions de vie décente sur la planète, en faisant droit à une double conception de la responsabilité à la fois comme imputation et comme mission189. L’imputation est liée à la redevabilité à l’égard des effets directs identifiables selon une relation de causalité : une entreprise doit rendre compte des impacts de son cœur de métier sur ses parties prenantes directes et il est possible de déterminer ce dont elle est directement responsable – par exemple, la pollution des cours d’eau engendrée par une usine, ou la quantité d’emballages utilisée pour commercialiser ses produits. La mission est liée à la reconnaissance des effets émergents relatifs aux actions conjointes de différents individus et différents groupes, dont les entreprises. Ainsi, une PME a une empreinte carbone limitée au regard des émissions sur son territoire, mais elle peut contribuer à limiter cette empreinte au nom de la responsabilité partagée avec d’autres acteurs vis-à-vis du climat. Ces bilans environnementaux constituent une porte d’entrée vers l’écoconception : une conception de produits qui en réduise autant que possible les impacts environnementaux tout au long de leur cycle de vie.
Une nouvelle approche systémique nécessite également d’étudier les effets des inégalités de revenus et de richesses sur le fonctionnement des entreprises et des sociétés. Elle appelle une réflexion sur la distribution des salaires et la rémunération des dirigeants pour vérifier si celles-ci contribuent ou non à la qualité du lien social et écologique. Les inégalités de revenus ont augmenté dans la plupart des pays ces dernières années, et les inégalités de patrimoines sont encore plus importantes que les inégalités de revenus. La mondialisation financière a contribué à ces augmentations190.
Des travaux ont montré que, sur le long terme, l’accroissement des inégalités de revenus et de patrimoine s’accompagne nécessairement d’une moindre croissance, voire d’une décroissance du revenu national191. D’autres études montrent comment le renforcement du lien social passe par une réduction des inégalités de revenus et de richesse : lorsque les inégalités augmentent, même les plus favorisés pâtissent de la dégradation du lien social192. Enfin, la préservation des écosystèmes et la transition écologique impliquent une réduction de la consommation « carbonée » des populations les plus favorisées ainsi qu’une augmentation du pouvoir d’achat des plus pauvres en vue d’une consommation de produits « verts »193.
2. Quelles normativités pour la transition ?
La grande transition conduit à réviser les normes juridiques et économiques par lesquelles nous définissons les chemins qui permettent de faire advenir les objectifs tant sociaux qu’écologiques.
Le droit de propriété est à la fois transformé par les exigences environnementales et mobilisé par et pour la protection environnementale. La notion même de propriété est reconfigurée par le droit de l’environnement dans la mesure où, d’une part, certaines de ses règles viennent gouverner les usages qui en sont faits et où, d’autre part, des règles visent certains biens, indépendamment de leur usage.
En France, la loi de 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite loi Pacte, a modifié le droit commun pour y faire entrer les notions nouvelles de « raison d’être » et de « société à mission ». Ces nouvelles formulations du droit n’assurent cependant pas que la création de valeur économique et financière soit subordonnée au respect des limites planétaires ni à un souci de justice sociale au sein des entreprises.
Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, l’Union européenne a mis en place le système d’échange de quotas d’émission fondé sur le principe pollueur-payeur sur lequel se fonde la politique de l’Union européenne en matière de lutte contre le changement climatique194. Pourtant, les objectifs de réduction de GES n’ont pas été atteints et la reproduction d’un mécanisme libéral de marché pour lutter contre les changements climatiques réaffirme l’écueil même du système.
Au-delà des normes environnementales, toutes les disciplines juridiques devraient être transformées pour faire face aux enjeux environnementaux. Pour que des évolutions du droit soient effectives, c’est tout le système de développement économique soutenu par le capitalisme et l’Etat libéral lui-même qui doit être reconsidéré.
Cette théorie visant à révolutionner le droit englobe trois aspects clés : 1) la théorie du droit doit se verdir et ainsi développer de nouveaux paradigmes pour contrecarrer les discours dominants ; 2) l’analyse juridique doit être décloisonnée afin de s’intéresser notamment à des catégories classiques telles que la notion d’Etat elle-même, de capitalisme, de souveraineté ; 3) les réformes juridiques ne doivent pas être la panacée de la transition, étant donné qu’elles sont insuffisantes pour répondre aux exigences actuelles et ne font que renforcer les contradictions qu’elles sont censées résoudre195.
A côté de l’adaptation du droit pour prendre en compte les enjeux environnementaux, on assiste à l’émergence de droits nouveaux qui se développent et s’enracinent dans les systèmes juridiques. Ce sont par exemple des droits procéduraux et aussi des droits substantiels, comme le droit de l’Homme à un environnement sain ou bien le principe de non-régression196, inscrits en France dans la loi sur la biodiversité. Un autre phénomène témoignant de cette transformation et de cette adaptation du droit aux enjeux environnementaux s’exprime par la prolifération de décisions qui accordent un statut juridique particulier aux éléments de la nature197.
Le droit évolue ainsi en se laissant inspirer par les débats relatifs à la place de l’être humain au sein de la nature, ainsi que par les débats relatifs à la valeur du vivant et des éco-systèmes.
Dans un autre domaine, l’exemple de la régulation des entreprises multinationales illustre bien les insuffisances du recours au droit mou (soft law) pour faire progresser la mise en œuvre des questions écologiques198. Le pouvoir de façonner les normes qui régulent la transition écologique n’est plus seulement la prérogative des acteurs étatiques : différents acteurs (notamment économiques) participent de plus en plus à l’élaboration normative199. La RSE est l’expression par excellence de ce phénomène. Elle a fait l’objet de plusieurs textes internationaux au sein d’instances publiques ou privées à l’instar des Nations Unies, de l’OCDE, de la Banque mondiale, de l’Union européenne ou encore de l’ISO200. Pourtant, les dangers de l’autorégulation et de la souplesse de la RSE n’ont pas cessé d’être dénoncés, en particulier celui de présenter comme « volontaire » ce qui est en réalité impératif, notamment en matière de droits fondamentaux201.
Même si les standards internationaux en matière de RSE relèvent surtout du droit mou (soft law), la force normative de la RSE ne cesse de s’accroître, notamment sous l’influence du droit international des droits de l’Homme202. La notion de due diligence ou devoir de vigilance devient centrale et contribue au durcissement de la RSE. L’adoption de la loi sur le devoir de vigilance en France (2017)203 témoigne de ce mouvement.
La combinaison entre hard et soft law est au cœur même de la loi sur le devoir de vigilance, puisque celle-ci renvoie largement au soft law pour sa mise en œuvre204. D’un côté, des outils du droit mou sont ainsi utilisés pour la mise en application du droit dur mais, d’un autre côté, des outils juridiques classiques sont susceptibles d’être mobilisés afin de conférer juridicité à des engagements considérés comme volontaires, notamment grâce à la judiciarisation de la RSE205.
3. Quelles institutions pour la transition ?
Les métriques par lesquelles nous évaluons les richesses à notre disposition et les trajectoires de nos sociétés ont des effets sur le fonctionnement de nos institutions. Cela nous invite à réfléchir à la manière dont nos démocraties contribuent ou pas à inscrire dans toutes les sphères de l’existence les questions écologiques et sociales, afin d’en faire la matrice à partir de laquelle les décisions sont prises.
Les régimes démocratiques doivent se réformer pour répondre aux enjeux du changement global, notamment pour faire face aux enjeux de long terme.
Les institutions ont été pensées sans qu’y soit intégrée la place de la nature. Alors que l’espace national est traditionnellement un espace d’expression démocratique fondamental, les phénomènes écologiques ne connaissent pas les frontières. Cela explique sans doute que les mouvements écologistes ont d’abord trouvé leur vitalité du côté des contre-pouvoirs et de l’interpellation, dans les territoires, à l’échelle européenne ou mondiale. Cela permet également de comprendre pourquoi les enjeux écologiques ont régulièrement été considérés comme secondaires dans les politiques gouvernementales par rapport à d’autres questions considérées comme plus stratégiques (commerce extérieur, sécurité, défense, fiscalité).
Les désordres écologiques sont devenus de plus en plus visibles et massifs. Cela rend incontournable l’organisation d’une transformation du système économique et social dans une perspective écologique. Mais cela rend aussi nécessaire une réflexion sur les manières démocratiques d’organiser cette transformation. Comment solliciter l’avis des citoyens ? Comment décider et selon quel calendrier ? Quelle part doit être donnée aux sciences, à l’expertise ? L’urgence écologique requiert la prise en considération de complexités nouvelles ainsi que des collaborations inédites entre acteurs publics et privés, individuels et collectifs, à toutes les échelles. Elle conduit à repenser l’ensemble du système des responsabilités. Articuler écologie et démocratie implique de donner à notre vie démocratique une nouvelle intensité et d’inventer de nouvelles formes démocratiques, qu’il s’agisse du développement de formes de démocratie directe, de démocratie délibérative ou encore de renforcement de la représentation des êtres affectés.
La gouvernance climatique et environnementale implique, outre les États, différentes institutions infra- et supra-nationales.
Le changement d’institutions répond à une conjonction de facteurs et de processus qui prennent place pour certains à l’échelle locale, pour d’autres à l’échelle nationale, régionale ou internationale. S’il faut valoriser des initiatives qui ont démontré leur exemplarité et les mobiliser pour définir les actions à entreprendre à d’autres niveaux d’organisation, le véritable défi, pour répondre aux enjeux d’une transition, est de penser et de promouvoir une conception multi-scalaire (à différentes échelles) du développement, faite d’itérations, d’innovations et d’apprentissages locaux et territoriaux, de politiques nationales ainsi que de la définition et de la mise en œuvre de cadres internationaux. En définitive, la gouvernance du climat implique l’articulation entre les différentes échelles, du plus local au plus global : sa mise en œuvre effective suppose que les acteurs infra-étatiques jouent un rôle clé.
Si le caractère global des questions climatiques ne fait pas débat, les questions liées à la biodiversité interrogent le niveau pertinent d’élaboration des décisions à la fois pour des raisons de légitimité et pour des raisons d’efficacité des décisions. La gouvernance de la biodiversité remet ainsi aussi en cause la division verticale et simpliste des responsabilités : acteurs locaux gérant des ressources locales, acteurs nationaux élaborant des politiques publiques et États négociant les normes internationales206. Par ailleurs, le changement d’échelle détermine aussi la nature et la disponibilité des connaissances qui peuvent être utilisées comme base pour la prise de décision207.
Relier les questions relatives aux biens communs (mondiaux), au bien commun et aux communs pour favoriser la recherche d’équité sur les territoires.
Les efforts pour instaurer de nouvelles métriques, de nouvelles régulations et de nouveaux modes de gouvernance sont liés à la recherche d’institutions qui soient cohérentes avec les grands enjeux planétaires. De ce point de vue, l’approche par les communs, plusieurs fois mentionnée208, favorise l’articulation entre les dimensions économiques, culturelles et politiques à travers les catégories de biens communs, bien commun et communs. Rappelons que les biens communs, au sens donné par les économistes, sont rivaux et non exclusifs209. Ce sont les biens et services, matériels et immatériels, auxquels tout être humain devrait pouvoir accéder aujourd’hui et demain. Le caractère conventionnel de la détermination des biens communs doit être reconnu et ouvre à la nécessité d’une délibération et d’une interprétation collectives sur la nature de ces biens communs210.
Le bien commun correspond à un idéal régulateur du bien vivre visé dans une société : ce vers quoi nous nous orientons collectivement et ce que nous cherchons à faire advenir. Ce sont les valeurs, les principes relatifs à la vie bonne et à la justice (voir porte Ethos) qui demandent à être incarnés dans nos projets de société.
La démarche des communs (voir Oikos) permet de mettre en évidence la dynamique politique d’émancipation qui conduit une communauté à déterminer ce que sont les biens communs à préserver, à partager et à transmettre211 en insistant sur les modalités de la gouvernance en commun, démocratique, etc. pour y parvenir. Cette perspective, qui s’inscrit en faux vis-à-vis des pratiques de marchandisation du vivant, d’accaparement public ou privé des terres, qui nie les droits des populations locales, et de financiarisation de l’économie et du pouvoir, invite à approfondir le lien entre justice et accord social. Cela invite à développer plusieurs interrogations : qui a les ressources et qui a la capacité de définir et de partager un bien ? Comment se met-on d’accord ?
Cette démarche s’applique tout particulièrement aux territoires sur lesquels se croisent les enjeux locaux, nationaux et mondiaux. Les territoires constituent des cadres pertinents pour reconnaître et administrer les biens communs mondiaux, et atteindre ainsi les objectifs du développement durable. A l’échelle qui les définit, en faisant le lien entre action collective et action publique, ils offrent, sous certaines conditions, l’opportunité de renforcer la capacité de multiples acteurs à se coordonner et à définir ensemble les orientations à poursuivre en intégrant objectifs environnementaux, sociaux et économiques.
L’importance de certains territoires pour le maintien des équilibres écologiques de la planète est telle que la question se pose de leur conférer le statut de bien commun universel. Des discussions à ce sujet existent à propos de la forêt amazonienne, victime de pratiques de déforestation massive liées notamment à l’exportation de soja et de viande vers les pays européens. Si le statut de bien commun universel attribuable à la forêt amazonienne peut être un outil pour gérer collectivement cet espace d’intérêt international, il ne peut suffire en lui-même : la transformation des ressorts économiques et sociaux transnationaux à l’origine de l’exploitation de cet espace doit tout autant être assumée collectivement, à toutes les échelles.
